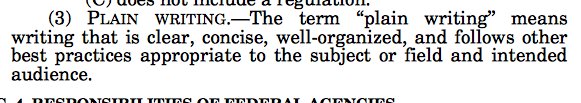Après les élections européennes, essayons de comprendre comment la communication en ligne est utilisée par les députés européens, avec Darren G. Lilleker et Karolina Koc-Michalska dans « Online political communication strategies: MEPs e-representation and self-representation »…
Quel équilibre entre les stratégies web de communication des eurodéputés ?
Trois modèles de communication se distinguent parmi les pratiques de communication des députés européens dans le web et les réseaux sociaux :
Premièrement, une communication traditionnelle axée sur la représentation, mettant en valeur le travail et les réalisations au sein du Parlement européen afin de démontrer son service actif et en quoi ce service profite à celles et ceux qu’il ou elle représentent.
Cette prédominance – facilitée par les plateformes sociales permettant de développer des liens entre l’élu et ses électeurs – suggère néanmoins peu d’innovation dans la communication des législateurs européens.
Deuxièmement, une stratégie de communication autour de la gestion de la réputation, de l’image personnelle, des caractéristiques individuelles du législateur, afin de valoriser la personnalité et le charisme de l’individu, comme éléments déterminants dans le choix des électeurs et des électrices.
Troisièmement, une stratégie de communication participative qui permet aux mandants de contacter l’élu, d’examiner des questions politiques et de contribuer à la réflexion du législateur ou de la législatrice.
Les députés européens qui permettent un certain degré de commentaires, sollicitent des réactions et sont proactifs en encourageant la participation sont les plus susceptibles de pouvoir améliorer la perception de leur efficacité politique.
Quels facteurs influencent les eurodéputés dans leurs stratégies de communication en ligne ?
La cartographie de la communication en ligne des députés européens se révèlent statistiquement significative :
Rien n’indique que les députés représentant des petits partis utilisent Internet pour attirer davantage l’attention des citoyens ou des médias que leurs homologues représentant des grands partis.
Une relation positive existe pour les députés élus selon des systèmes de vote plus personnalisés, contrairement au vote par liste. Le fait que le système de vote semble important pour la performance globale en ligne indique que les députés européens élus en tant qu’individus, et non à partir d’une liste de parti, voient dans une présence en ligne plus innovante un avantage pour l’électorat ou, à tout le moins, ne nuisent pas à leurs chances de réélection, mettant en évidence un choix rationnel dans leur stratégie.
L’âge et la durée du mandat sont des prédicteurs clés de l’innovation en ligne : les plus jeunes députés européens et ceux qui siègent au Parlement européen pour leur premier mandat sont plus susceptibles de poursuivre une stratégie de communication participative.
Les partis de gauche semblent plus susceptibles de suivre la fourniture d’informations, tandis que, globalement, les partis de droite sont les plus susceptibles de suivre la stratégie de gestion de la réputation. Les députés européens des partis mineurs surclassent toutes les stratégies.
La différence de génération n’est pas statistiquement significative pour la 1e stratégie d’information, contrairement à la stratégie de communication participative, où l’âge du député européen est un indicateur fort, les plus jeunes étant les plus susceptibles d’être interactifs. En termes de gestion de l’image, il existe également un net fossé générationnel, les plus jeunes étant les plus susceptibles d’avoir recours à cette stratégie.
Au total, la stratégie de communication participative est en train de constituer un capital politique, puisqu’elle s’avère payante en permettant à l’eurodéputé(e) de trouver un public qui discutera politique, échangera des idées et amplifiera ses campagnes.